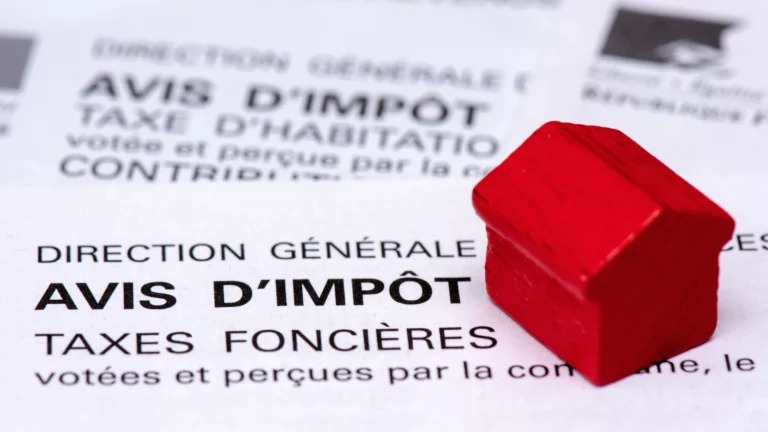- Par Ambre Levesque
- Publié le
Abonnez-vous à la newsletter Capital Durable
Recevez nos enquêtes, guides et conseils chaque semaine.
Les coquilles d’huîtres : le calcaire marin au service du bâtiment
Des coquilles d’huîtres, du déchet marin à la ressource circulaire
Un gisement de coquilles d’huîtres encore sous-exploité
En France, la consommation d’huîtres génère près de 150 000 tonnes de coquilles par an, selon l’ADEME. Chaque année, une grande partie finit encore dans les décharges ou les dépôts marins. Ces déchets posent un problème environnemental : ils se décomposent lentement et libèrent du soufre dans les sols.
Cependant, les coquilles sont composées à plus de 95 % de carbonate de calcium, une matière première équivalente à celle du calcaire industriel.
Ainsi, leur réutilisation permet de remplacer une ressource extraite par une ressource déjà disponible sur le littoral.
Des acteurs comme Agrivalor Bretagne ont compris ce potentiel. Ils collectent et lavent les coquilles auprès des ostréiculteurs pour les transformer en granulats destinés à la construction ou à l’agriculture. De cette manière, le littoral devient un territoire exemplaire d’économie circulaire.
Le calcaire marin, une ressource naturelle et locale
Les coquilles subissent un processus simple : lavage, séchage, broyage, puis transformation en poudre ou en granulats.
En parallèle, plusieurs laboratoires étudient leur intégration dans les bétons et enduits écologiques.
Leur granulométrie fine permet une utilisation comme charge minérale dans les mortiers à la chaux. De plus, elles réduisent la consommation de ciment, matériau très émetteur de CO₂.
Une étude de l’Université de Nantes a démontré que l’ajout de 30 % de poudre de coquilles dans un mortier réduit les émissions carbone de 15 %.
En résumé, ce recyclage local offre une double vertu : limiter les déchets marins et d’autre part, il crée une ressource pour le bâtiment.

Les usages des coquilles d’huîtres dans la construction
Enduits et mortiers à base de calcaire marin
Mélangées à de la chaux naturelle, les coquilles d’huîtres broyées produisent des enduits respirants, résistants et lumineux.
Ce calcaire marin apporte une texture unique, à la fois lisse et légèrement nacrée.
Ainsi, il trouve sa place dans la restauration de bâtiments anciens ou les projets d’architecture durable.
Des artisans bretons expérimentent déjà ce matériau dans des maisons et bâtiments publics.
Le projet Coquillages & Chaux, soutenu par Bruded, valorise cette approche locale, sobre et esthétique. En outre, plusieurs écoles d’architecture l’intègrent à leurs programmes de recherche sur les enduits biosourcés. Ces initiatives montrent que la matière première locale peut allier esthétique, performance et durabilité.
Bétons écologiques issus des coquilles d’huîtres
Les coquilles d’huîtres ne servent pas qu’à l’enduit : elles entrent aussi dans la composition de bétons perméables.
En effet, leur structure poreuse favorise l’infiltration de l’eau et prévient les inondations.
Ces bétons drainants s’utilisent pour les trottoirs, parkings ou cours d’écoles.
La société française Néolithe explore également leur usage comme agrégats dans ses bétons « fossilisés », issus de déchets non recyclables.
De ce fait, la filière des coquilles participe à la décarbonation de la construction tout en valorisant un gisement local.
« Les coquilles d’huîtres prouvent qu’un déchet peut devenir un matériau noble. »
Élodie Martin, ingénieure matériaux – Néolithe (2024)
Une économie circulaire des coquilles d’huîtres sur le littoral
La Bretagne, pionnière du recyclage coquillier
La région Bretagne concentre la majorité des initiatives de valorisation des coquilles.
Des coopératives locales, soutenues par l’ADEME et la Région Bretagne, collectent les déchets ostréicoles pour les intégrer dans des filières industrielles et artisanales.
Ainsi, les ostréiculteurs participent à une boucle vertueuse : leurs déchets deviennent des matériaux de construction.
Des réseaux comme Bruded et Bretagne Éco-Entreprises accompagnent ces projets, alliant innovation et économie locale.
De plus, certaines collectivités testent des usages complémentaires : stabilisation de chemins communaux, mobilier urbain et sols perméables.
En conséquence, la Bretagne illustre parfaitement comment la ressource locale peut alimenter une économie circulaire durable.
Vers un modèle réplicable sur tout le littoral
En Normandie, en Charente-Maritime et en Vendée, plusieurs communes testent la fabrication de sols drainants et bétons écologiques à base de coquilles.
Cependant, le coût de collecte et le manque de normes techniques freinent encore le déploiement massif.
Toutefois, la demande croissante en matériaux recyclés pousse les régions à accélérer.
Des programmes soutenus par France Relance et l’ADEME visent à structurer cette filière d’ici 2026.
En conclusion, la Bretagne montre la voie d’une économie circulaire littorale, exportable à l’ensemble des zones côtières françaises.
Abonnez-vous à la newsletter Capital Durable
Recevez nos enquêtes, guides et conseils chaque semaine.
Capital Durable
Le média de l’immobilier écologique
La construction durable au cœur des territoires de demain
La transition écologique impose de repenser nos façons de construire. Matériaux responsables, techniques sobres et solutions bas carbone permettent de réduire l’impact du bâtiment tout en améliorant le confort et la performance des espaces de vie.
L’éco-construction et les approches bioclimatiques ouvrent la voie à des architectures plus résilientes et mieux adaptées aux enjeux contemporains. En valorisant ces innovations, nous accompagnons l’évolution d’un secteur essentiel vers plus de responsabilité et d’efficacité.
Ensemble, imaginons une construction qui protège l’environnement tout en façonnant durablement nos territoires.